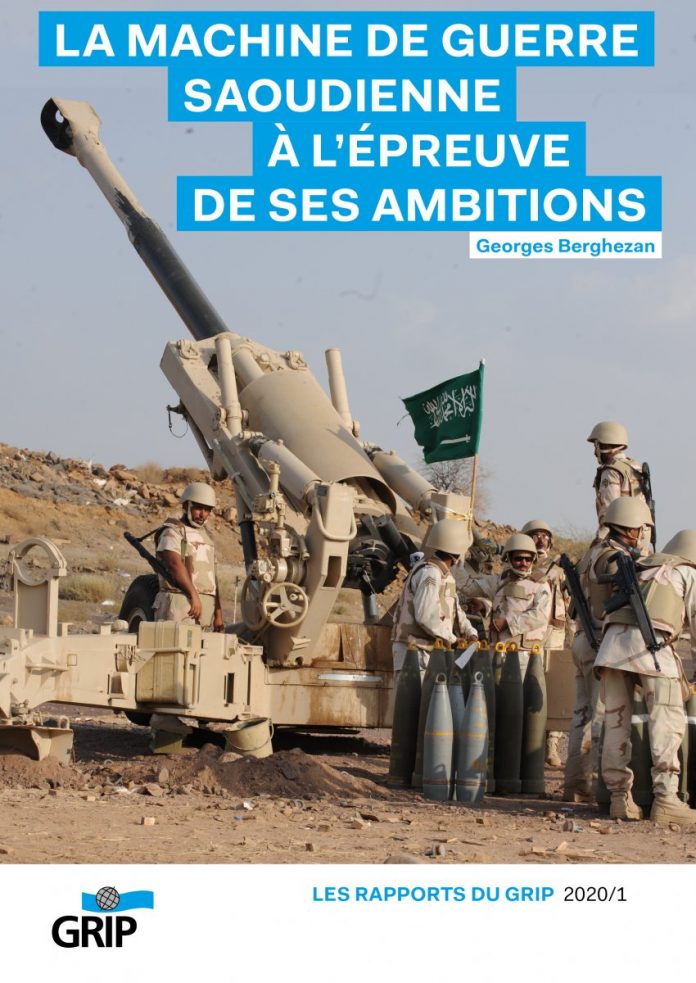Ce rapport entend présenter les caractéristiques majeures de l’appareil de défense et de sécurité de l’Arabie saoudite. Un des principaux constats à la base de cette étude est que, particulièrement depuis l’accession du prince Mohammed ben Salmane à la tête du ministère de la Défense en 2015, le royaume ne se contente plus d’être le meilleur client des marchands d’armes de la planète, comme il l’a été depuis des décennies. Contrairement aux oracles qui justifiaient les fournitures des armements les plus sophistiqués à l’Arabie saoudite en affirmant qu’ils n’avaient pas pour vocation d’être utilisés, on constate qu’ils servent à des interventions extérieures dans un contexte où l’Arabie saoudite cherche à s’affirmer comme une puissance militaire moyen-orientale majeure.
Cette étude vise donc, sur base de sources ouvertes, à examiner l’évolution des dépenses militaires de l’Arabie saoudite et sa place dans le marché international de l’armement, ainsi que son développement d’une industrie domestique de défense. Ensuite, elle tâche de décrire la structure de ses forces de défense et de sécurité (forces armées, garde nationale, agences de renseignement et forces de sécurité intérieure), identifier les changements récents dans la chaine de commandement et l’autorité de tutelle de chacune d’entre elles, ainsi que les effectifs et matériels à leur disposition. Les réformes et bouleversements intervenus depuis 2015 suggèrent une emprise grandissante sur l’ensemble de l’appareil militaro-sécuritaire par le prince ben Salmane. Enfin, l’étude se penche sur l’intervention de la coalition dirigée par Ryad au Yémen, notamment en termes d’équipement et effectifs engagés, et sur le constat d’échec que peuvent difficilement cacher les forces pro-saoudiennes.
Commander le Rapport – en version epub ou en version papier livrée chez vous
Skip to PDF contentCrédit photo : ministère de la défense d’Arabie saoudite
Georges Berghezan était chercheur de 2000 à 2022.Après avoir travaillé au GRIP durant les années 1980, Georges Berghezan y est revenu au début des années 2000. Il concentre depuis ses activités sur les nombreux conflits « post-guerre froide », particulièrement en Afrique subsaharienne, et sur les outils servant à les mener, les armes légères et de petit calibre, dont l’utilisation et les transferts commencent seulement à être quelque peu réglementés. C’est donc autour de ces deux problématiques – Afrique et armes légères – que Georges Berghezan menait la plupart de ses activités.