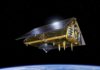Les purges en Turquie sont largement relayées et dénoncées par la presse internationale depuis le putsch manqué du 15 juillet 2016. L’ampleur des atteintes portées au pilier de l’état de droit qu’est le système judiciaire a en effet de quoi interpeller : des procès éclairs en série, des motifs d’accusation obscurs et quelque 4 000 magistrats limogés par décret depuis le coup d’État avorté. Mais l’instrumentalisation de l’appareil judiciaire turc ne date pas de juillet 2016, il est un enjeu de pouvoir visible entre forces politiques turques depuis une dizaine d’années.
En effet, depuis l’arrivée au pouvoir de l’AKP, en 2002, l’évolution du système judiciaire est fonction des relations entre trois acteurs concurrents de l’échiquier politique : le mouvement religieux Hizmet de Fethullah Gülen[1], le parti AKP de Recep Tayyip Erdogan, et l’armée, bastion du kémalisme laïcisant. Ainsi, les attaques portées par le gouvernement de l’AKP à l’intégrité et l’indépendance de la justice après le putsch manqué ne font que témoigner de la relation conflictuelle existant entre l’AKP et Gülen depuis 2013, tout en poursuivant l’opération de neutralisation de l’armée à l’œuvre depuis une dizaine d’années. Ces attaques consistent en plusieurs réformes des institutions judiciaires, le noyautage de celles-ci par l’AKP et des pressions directes du gouvernement sur le personnel juridique. La mise au pas de l’indépendance judiciaire turque, précipitée par le contexte chaotique créé par le coup d’État combiné à l’état d’urgence, est d’autant plus inquiétante qu’elle semble irréversible à court terme.
Crédit photo : Marche pour la Justice en juillet 2017 (source : Ziya Koseoglu/CHP)
Réformes des institutions judiciaires : l’emprise progressive de l’exécutif
La Constitution turque, dont l’article 138 garantit l’indépendance judiciaire, définit la structure du système judiciaire, qui comprend trois ordres de juridiction : administratif, judiciaire et militaire. Chacun d’entre eux, à l’exception de l’ordre militaire, fait la distinction entre justice civile et pénale. C’est pourquoi les juridictions administrative et judiciaire comprennent chacune deux cours de première instance, une cour de district et une cour suprême qui agit en tant que décideur final (le Conseil d’État pour l’administratif et la Cour de cassation pour le judiciaire). Enfin, deux cours suprêmes dominent l’ensemble du système judicaire : la Cour constitutionnelle et la Cour des conflits juridictionnels. Une autre instance majeure convient d’être mentionnée : le conseil supérieur des juges et des procureurs (HSYK), entre autres chargé de la nomination, promotion, affectation et licenciements des juges et procureurs.
Le HSYK et la Cour constitutionnelle sont certainement les deux instances judiciaires les plus puissantes en Turquie et à la fois les plus touchées par des révisions constitutionnelles qui égratignent toujours plus leur principe d’indépendance. Le 3 novembre 2002, l’AKP remporte les élections législatives et obtient pour la première fois la majorité absolue au Parlement.
Le parti d’Erdogan, nommé Premier ministre en 2003, n’a de cesse depuis cette date de dominer l’hémicycle remportant les élections législatives en 2007, 2011 et 2015[2]. Dès lors, les réformes de l’institution judiciaire se multiplient. En septembre 2010, une première révision constitutionnelle modifie la composition de la Cour constitutionnelle et du HSYK qui voient leurs membres passer respectivement de 11 à 17 et de 7 à 22. Le procédé de nomination des membres du HSYK, autrefois conféré au Conseil d’État et à la Cour de cassation, est bouleversé par la réforme qui charge le Président de la République ainsi que des juges de l’ordre judiciaire et administratif d’une grande partie des nominations des membres. La Cour de cassation voit, elle, son pouvoir réduit : le lancement des procédures de dissolution des partis politiques, dont elle avait jusqu’alors l’exclusivité, est désormais conditionné au vote du Parlement. À l’époque, l’adoption de ces amendements est largement plébiscitée par l’Union européenne, qui salue la nomination des membres du corps judiciaire par leurs pairs. En février 2014, le Parlement turc adopte une loi qui prévoit d’accorder au ministre de la Justice le dernier mot en matière de nomination des magistrats renforçant ainsi considérablement le contrôle ministériel sur les membres du HSYK. La Cour constitutionnelle juge cependant la loi en grande partie inconstitutionnelle et oblige le gouvernement à la réviser quelques mois plus tard. Cette décision n’est toutefois pas rétroactive et n’aura pas permis d’empêcher la nomination d’un certain nombre de procureurs et magistrats par le gouvernement en place. Par ailleurs, en vertu de la nouvelle Constitution votée par référendum en avril 2017, tandis que le nombre des membres du HSYK et de la cour constitutionnelle est revu à la baisse, le Président est davantage chargé de la nomination des membres avec l’introduction du ministre de la Justice et de son vice-ministre en tant que membres de droit. Au total, parmi les 28 membres des deux instances,18 seraient nommés par le Président et dix par le Parlement[3]. De plus, la réforme octroie au Président le droit d’être affilié à un parti politique, ce qui permet à Erdogan de se faire élire à la tête du parti AKP en mai 2017. Ce rôle lui confère assurément une autorité de fait sur le groupe parlementaire du parti qu’il dirige, rendant presque illusoire « l’autonomie » du Parlement dans le choix des dix membres restants de la Cour constitutionnelle et du HSYK.
L’armée, qui a longtemps occupé une place de premier ordre sur la scène politique turque, n’a pas non plus été épargnée par la restructuration du système judiciaire avec une absorption progressive de la justice militaire par son homologue civile. Dans le cadre des négociations d’adhésion à l’Union européenne, un ensemble de réformes a contribué à la démilitarisation de la justice en 2010. Parmi elles, la fin des comparutions des civils devant des tribunaux militaires, et la possibilité d’introduire un recours devant une juridiction civile concernant des décisions de la Cour de cassation militaire et du Conseil militaire suprême. Enfin, les tribunaux civils ont été habilités à juger les militaires en cas de crimes commis contre la sûreté de l’État et l’ordre constitutionnel. Ce contrôle civil des forces armées a culminé dans la suppression pure et simple des tribunaux militaires, sauf dans le cas de sanctions disciplinaires à l’encontre de soldats, dans le contexte du putsch manqué.
Instrumentalisation de la magistrature : enjeu de pouvoir entre Erdogan et Gülen
Au-delà des mesures législatives et des réformes institutionnelles qui mettent à mal le principe d’indépendance de la justice turque, l’intégrité et l’impartialité des juges et des procureurs semblent plus que jamais compromises.
Par le passé, plusieurs scandales avaient permis de mettre en lumière l’influence exercée par les forces politiques sur l’appareil judiciaire, particulièrement celle du mouvement de Gülen. L’affaire Ergenekon[4] en 2007, qui avait débouché sur des arrestations massives de militaires, avait été décriée pour ses méthodes juridiques très controversées. Pour un certain nombre d’observateurs, l’AKP a favorisé et encouragé le noyautage par les partisans de Gülen du pouvoir judiciaire avant 2013, à l’époque où les deux entités partageaient en commun la lutte contre l’establishment militaire et laïc. Bien que l’influence du mouvement ne puisse pas être mesurée, il est apparu que des magistrats liés à Gülen avaient joué un rôle prépondérant dans l’affaire Ergenekon et permis une première épuration dans les rangs de l’armée. Un certain nombre de condamnés avaient d’ailleurs été libérés en mars 2014 avec l’aval du gouvernement AKP, qui suggéra même qu’ils avaient été victimes des « gülenistes ». L’alliance entre l’AKP et Gülen avait en effet pris fin de manière définitive avec le scandale de corruption qui a ébranlé le président turc en 2013. L’enquête le touchait directement puisqu’elle visait quatre ministres accusés de corruption à grande échelle dans des marchés publics immobiliers ou des transactions financières illégales avec l’Iran. En réaction, plusieurs procureurs et magistrats, accusés d’être affiliés à Gülen et jugés responsables de l’ouverture de l’enquête, avaient été limogés.
À la suite du putsch manqué de juillet 2016, dont Gülen est rendu responsable par le gouvernement AKP, celui-ci frappe plus fort puisqu’en vertu des pouvoirs conférés par l’état d’urgence, il limoge par simple décret à effet immédiat le quart des juges et procureurs de la magistrature. Face aux chefs d’accusations imprécis et impersonnels, les juges et procureurs toujours en poste redoutent d’être à leur tour renvoyés de manière arbitraire. Certains magistrats arrêtés témoignent par ailleurs de leurs interrogatoires et affirment que les questions posées pendant leur garde à vue portaient davantage sur l’élection des membres du HYSK en 2014 que sur la préparation du putsch[5]. Finalement, l’appareil judiciaire, qui était autrefois réputé sous la coupe de Gülen, est désormais infiltré par des cadres de l’AKP : sur 900 nouveaux juges nommés, 800 présenteraient des liens directs avec le parti au pouvoir[6]. Le 30 août 2017, une nouvelle polémique a éclaté alors que le président de la Cour constitutionnelle, Zühtü Arslan, a été photographié s’inclinant devant Erdogan[7], ce qui relance le débat sur la partialité du système judiciaire.
Impuissance nationale et timidité européenne
Au cours de la dernière décennie, des tentatives de réformes de l’AKP ont à maintes reprises été contrecarrées par la cour constitutionnelle comme la réforme tendant à lever l’interdiction du port du voile à l’université ou encore la censure des sites Youtube et Twitter. La Cour de cassation avait même déposé une demande d’interdiction de l’AKP en 2008 pour « activités anti-laïques ». Le champ d’action du pouvoir judiciaire semble cependant aujourd’hui considérablement réduit. Les dernières décisions judiciaires rendues ne sont même plus reconnues par l’exécutif qui viole le principe de séparation des pouvoirs. En février 2016, Erdogan avait par exemple déclaré ne pas accepter et ne pas respecter la décision de la Cour constitutionnelle qui avait jugée inconstitutionnelle l’arrestation de deux journalistes[8]. L’association de magistrats démocrates Yarsav, qui alertait la communauté internationale sur l’aggravation de la mise au pas de la magistrature depuis plusieurs années, a été dissoute en mars 2016. Le rétablissement de l’état de droit en Turquie semble compromis dans un état d’urgence qui confère à l’exécutif la mainmise sur l’exercice judiciaire sans aucune espèce de contrôle. Les décrets émis par le gouvernement et à effet immédiat ne peuvent être annulés que par le Parlement, dominé largement par l’AKP. L’absence d’alternance politique et d’une opposition large contribue à la désintégration de l’appareil judiciaire. Dans l’hypothèse où Erdogan serait élu président de la République en 2019, l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution laisse croire que l’état de « non droit » dans lequel s’est plongé la Turquie va perdurer. Un tel scénario couplé avec une nouvelle majorité parlementaire de l’AKP rendrait pratiquement inexistants les contrôles du pouvoir présidentiel. L’opposition s’efforce pourtant de s’emparer de la question judiciaire, comme le parti kémaliste, le CHP, qui a organisé une manifestation le 9 juillet 2017.
Surnommée « Marche pour la justice », elle avait été organisée afin de protester contre l’incarcération d’un élu du CHP et avait rassemblé des dizaines de milliers de personnes, faisant d’elle la plus grande manifestation d’opposition au président Erdogan depuis le mouvement contestataire de 2013. Les retombées de ce mouvement sont encore très incertaines et sa portée demeure pour l’instant symbolique.
Si les tentatives de contenir la déliquescence de l’état de droit au niveau national semblent plus que limitées, l’Union européenne s’efforce tant bien que mal de jouer de son influence. Ses organes alertent quotidiennement, sous la forme de rapports, des atteintes à l’indépendance judiciaire, le Réseau européen des Conseils de la Justice (RECJ) allant même jusqu’à suspendre le HSYK du réseau européen des conseils de justice en décembre 2016. Ses actions restent toutefois timides. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avait par exemple rejeté un recours d’une magistrate turque au motif qu’elle n’avait pas épuisé les recours internes en Turquie[9], alors même que l’Union reconnaissait les failles du système judiciaire turc. La simple menace d’une « suspension » des négociations d’adhésion de la Turquie échoue également à envoyer un avertissement fort au gouvernement turc. Finalement, l’Union européenne s’enlise dans des négociations de « marchandage », comme en mai 2016, lorsqu’elle avait demandé à la Turquie de modifier sa loi antiterroriste, dont le champ d’application était jugé trop large, en échange d’une exemption de visas pour ses citoyens voulant se rendre dans l’espace Schengen.
L’auteur
Hélène Voisin est chercheure stagiaire au GRIP et étudiante en Master 1 Affaires internationales et développement à l’université Paris-Dauphine.
Télécharger la version PDF :
Turquie: l’indépendance de la justice en danger
[1]. En exil aux États-Unis, cet imam est présenté par le gouvernement turc comme le principal commanditaire du putsch. Toutefois, il était, jusqu’en 2013, un allié de l’AKP dans sa lutte contre les kémalistes, notamment au sein de l’armée.
[2]. L’AKP avait perdu brièvement sa majorité parlementaire absolue en juin 2015 à l’issue d’un scrutin législatif, mais l’a restaurée en novembre de la même année.
[3]. Le nombre des membres du HSYK passe à treize. Le président conserve son pouvoir de nomination de six d’entre eux puisqu’à la nomination présidentielle directe de quatre membres s’ajoute la nomination du ministre et vice-ministre de la Justice (le Parlement nomme les sept membres restants). Pour la Cour constitutionnelle, le nombre de membres passe à quinze et le Président garde la main sur la nomination de douze membres.
[4]. En juin 2007, lors d’une opération antiterroriste dans un bidonville d’Istanbul, des armes et des explosifs sont découverts, faisant croire aux autorités l’existence d’un réseau dont l’objectif était l’affaiblissement, voire le renversement du gouvernement AKP.
[5]. SHAHEEN Kareem, « March for Turkey’s jailed judges highlights purge on dissidents », The Guardian, 7 juillet 2017.
[6]. Idem.
[7]. « AYM Başkanı Zühtü Arslan ‘eğildiği’ fotoğrafı savundu », Cumhuriyet, 5 septembre 2017.
[8]. PITEL Laura, « Turkey’s president Erdogan rejects court ruling to free journalists », The Independent, 28 février 2016.
[9]. CEDH, MERCAN c. TURQUIE, 8 novembre 2016, 56511/16